Paola Audrey Ndengue, un maître d’oeuvre de la culture urbaine africaine (3)
Hi guys !
Je viens juste de me rendre compte que le repas compte en fait trois plats de résistance avant le dessert. J’ai posé pas mal de questions, rires. Le plaisir n’en sera que plus grand. Pour ceux qui nous rejoignent, nous menons en ce moment une série d’interviews et d’articles intitulée « Les Hommes des médias » sur le blog. Notre premier invité, Paola Audrey Ndengue (PAN), nous a précédemment entretenus de ses étiquettes, de marketing d’influence et de blogging dans la première partie de cette interview ; nous avons ensuite parlé de l’évolution des médias, de leur monétisation et des problématiques liées au branding d’une entreprise et de son fondateur. Aujourd’hui, elle nous relatera son parcours, et nous racontera l’histoire du média qu’elle a cofondé : Fashizblack.
Paola Audrey, un maître d’oeuvre de la culture africaine
Partie 1 : Étiquettes, Marketing d’influence et Blogging
Partie 2 : Evolution des médias, Monétisation et problématiques du branding
Partie 3 : Le parcours de Paola Audrey, son mindset et l’Histoire de Fashizblack
Ceux qui souhaitent lire (ou relire) les parties précédentes de l’interview peuvent se référer au sommaire ci-dessus. Pour les autres : vous êtes prêts ? Alors allons-y !
Partie 3
Le parcours de Paola Audrey, son Mindset, et l’Histoire de Fashizblack
Le mindset de Paola Audrey
La dernière fois, PAN nous parlait des critères de succès qu’elle partage avec ses associés (Fashizblack a trois cofondateurs : Paola Audrey, Patrick Privat et Laura Songue) :
PAN : nos critères de succès sont toujours très factuels, que cela porte sur l’entreprise ou sur notre vie personnelle. Un exemple un peu bête : l’un de mes critères de succès est de me dire, « le jour où j’aurais suffisamment d’argent et de ressources humaines sur lesquelles je puisse m’appuyer pour aller me reposer au Japon pendant un mois sans que cela n’affecte mes entreprises, j’aurais atteint un palier déterminant ». Pour moi ce genre de choses… de situations précises, qui se traduisent à la fois de manière quantitative et qualitative, sont factuelles. Baser ses critères de succès sur des pacotilles est dangereux, cela donne l’impression aux gens qu’ils sont très rapidement « arrivés ». Et du coup ça fausse complètement la compréhension qu’ils ont de ce qu’ils font, de la raison pour laquelle ils le font, de leur stratégie, et même de leur propre marque.
Les règles sont biaisées d’entrée de jeu parce que tu as mis la barre tellement bas qu’en fait oui, tu l’atteins très vite et tu te dis : « ça y est, j’ai percé ! » Tu crois que ta boîte est en sur-croissance alors qu’elle stagne complètement, car le genre de critères dont tu te sers pour évaluer son développement c’est la façon dont on parle de toi, son fondateur. C’est un critère mais ça ne peut pas être « le » critère principal, ce n’est pas possible. Surtout de nos jours, où la notoriété peut se fabriquer très facilement. Je pense qu’il faut également des critères d’auto-évaluation pertinents, factuels, qui permettent de mesurer l’avant et l’après ; de voir à quel moment il y a eu évolution. C’est ma vision des critères de succès.

L : tu es citée en modèle par beaucoup de jeunes, j’ai l’impression que ce rôle de role model (exemple de réussite, personne à qui l’on aspire à ressembler), ça t’a pris par surprise, que tu ne l’acceptes pas vraiment. C’était à contrecœur ?
PAN : c’était à contrecœur. Jusqu’aujourd’hui je ne me considère pas comme un role model, je n’ai pas envie d’en être un. A partir du moment où on se considère comme tel, on s’aliène sa liberté de faire des erreurs. Je veux avoir la liberté de me tromper sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Quand on est un role model et qu’on se dit « je suis un role model« , je traduis « j’ai décidé d’être un exemple ». « J’ai décidé de mettre ma vie, mes pensées, ma personnalité au service d’autres personnes parce que je veux les inspirer ». Je ne vais jamais faire un truc comme ça, je ne vais jamais dire un truc comme ça. Ma vie est suffisamment compliquée, je ne vais pas en plus la prendre, la refaçonner, puis dire aux gens : « ah tenez ! Je suis le pain, livré pour vous… » Non. C’est hors de question. Je ne serais pas arrivé où je suis si j’avais été un role model.
J’en suis arrivée là parce que j’ai eu un parcours atypique, au cours duquel j’ai vagabondé à gauche à droite. Je veux pouvoir continuer à avoir cette liberté sans avoir, à chaque fois que je fais un pas qui ne correspond pas à ce que les gens attendraient que je fasse, à me justifier face à des tribunes, un bouquin, un micro ou que sais-je… où l’on m’expliquerait que je ne devais pas faire les choix que j’ai faits. Au nom de quoi ? Jamais. Je ne veux absolument pas être un role model.
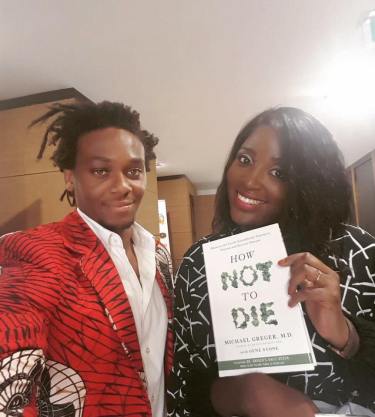
Source : Instagram @paolaaudrey
J’étais à l’Inspir’Talk dernièrement*, certaines personnes venaient me voir en me disant : « je te suis depuis longtemps, tu m’inspires ! » Je ne sais jamais quoi dire dans ce genre de situation. Les gens croient que je ne réponds pas parce que je suis blasée à force de l’entendre mais en fait, ce n’est pas le cas. C’est juste que c’est tellement éloigné de mon équation quand je fais quelque chose que ça me prend au dépourvu, ce n’est pas… prévu dans ma stratégie. Ma réflexion est très égoïste ; quand j’ai envie d’arriver à un endroit, je me demande ce qu’il faut que je fasse, les étapes que je dois franchir pour y parvenir. Les questions que je me pose sont : « comment je dois faire pour y arriver ? », « de quoi ou de qui j’aurais besoin ? », « en combien de temps je vais y arriver ? » etc. C’est très étudié, analysé, calculé. Et dans toute cette équation, « est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que des jeunes femmes soient inspirées ? » n’a pas sa place. Ça m’arrive maintenant de m’en rendre compte, de commencer à me dire « ah d’accord ! » parce que j’ai des retours de temps en temps, des personnes qui viennent me dire « ah tu as dit ça la dernière fois » ou « tu as fait ça la dernière fois », « ça m’a poussé à faire telle ou telle chose »… Ce serait hypocrite de dire que je ne le vois pas, je le vois maintenant. Mais ça n’a jamais été une volonté délibérée.
Je pense que si j’avais été un role model, je n’aurais pas pu être aussi subversive dans mes écrits, il y a quelques années. Au contraire, tout ce que je voulais c’était une plateforme pour m’exprimer, pour pouvoir dire ce que je pense. Je trouvais qu’il y avait un côté politiquement correct sur internet qui devenait un peu chiant. Bloguer était fun, c’était ma petite fenêtre de liberté sur la toile. Après, ça a probablement donné l’impression que j’avais créé une forme de personnage – que les gens ont apprécié ou pas du tout. Et parmi ceux qui ont apprécié, certains ont commencé à me suivre. A l’événement, quelqu’un m’a dit « je te suis depuis Maybach Carter sur Skyblog ! ». Je me suis dit « purée, ça fait quand même dix ans ! C’est hallucinant qu’il y ait des gens qui me suivent depuis aussi longtemps ! » Quelqu’un qui suit mon parcours depuis dix ans a eu le temps de voir ma « progression » entre guillemets, et peut-être que oui, ça lui a peut-être inspiré des choses. Mais je n’ai pas assez de recul pour dire (voix parodique) « oui, c’est vrai que j’ai vraiment eu un parcours qui devrait inspirer les jeunes femmes ! » Non, jamais de la vie.
Et je ne conseillerais pas forcément à des jeunes femmes de faire exactement ce que j’ai fait, parce que chaque vie est spéciale, chaque parcours est particulier. Personnel. Par contre, si certains trouvent dans ce que je fais – dans ma manière de gérer ce que je fais, dans ma liberté de pouvoir dire ou faire certaines choses -, une source d’inspiration pour pouvoir être un peu plus sincère avec eux-mêmes, c’est super ! J’en suis honorée et oui, je me sens pleine d’humilité vis-à-vis de cela. Même si ça ne change pas le fait que je ne me lèverais jamais tous les matins en me disant (voix railleuse) « il faut que j’inspire la jeunesse aujourd’hui ! » (Rires)
Son parcours
L : pour revenir sur ton parcours, tu commences les classes prépatoires à Henri IV, l’une des meilleures prépas de France. Qu’est-ce qui se passe, pourquoi tu quittes la prépa pour aller à la Sorbonne ?
PAN : je quitte la prépa pour la Sorbonne parce que j’ai réalisé que je suivais le parcours que ma mère me proposait, qui n’était pas nécessairement celui que je voulais. Et que ce n’est pas parce que j’avais des facilités à faire certaines choses que je devais les faire absolument. Je suis allé en prépa pour faire plaisir à maman mais quand j’y suis arrivé, j’y ai eu une espèce de… révélation. Qui coïncidait avec la naissance de Fashizblack. C’est avec Fashizblack que j’ai commencé à me dire : « en fait, j’ai plutôt envie de faire ça ». J’ai beaucoup hésité puis à un moment donné, je me suis demandé si c’était vraiment important que j’aille à l’ENS (Normal Sup’ ndlr). Non en fait, pas vraiment. Ça ne me passionne pas, je n’ai pas envie d’enseigner. Je n’ai pas non plus envie de faire de la recherche, je voudrais plutôt faire une école de commerce. Mais l’école de commerce tout de suite ne me dit pas grand-chose. Après réflexion, je me suis dirigé vers la fac le temps de me resituer, pour éviter de perdre une année. C’est comme ça que j’ai bifurqué du chemin prépa – Sciences Po et compagnie. Finir et travailler dans un domaine qui plairait à ma mère… Je me suis dit que ce n’était pas ce à quoi j’aspirais.
L’Histoire de Fashizblack

L : comment est né Fashizblack ? On raconte que c’était un blog qui a ouvert en 2007, mais comment as-tu rencontré tes cofondateurs – Patrick et Laura ? Comment vous êtes-vous lancés ? Comment est née l’idée ?
PAN : à l’époque, je tenais mon second blog. Je parlais un peu de mode, mais pas que. Un jour, un mec que je connaissais – qui vivait en Afrique du Sud, un Camerounais qui y faisait ses études -, vient me voir en me disant qu’il a envie de lancer un blog de mode. Il voulait l’appeler « Afroglam' ». Son but était de mettre les personnes noires en avant, et il voulait qu’on le gère tous les deux. J’ai donné mon accord mais je n’étais pas trop convaincue par le nom, qu’on a fini par changer. Nous avons ramené une troisième fille – une connaissance commune -, puis un quatrième membre dans le projet. Nous étions quatre quand nous nous sommes lancés, après avoir choisi un nouveau nom. C’était en novembre-décembre 2007, j’étais en prépa. Patrick nous a rejoints par la suite, puis Laura. L’équipe a progressivement grandi, et a fini par compter trente membres. C’est dire à quel point nous étions… La folie de la jeunesse (sourire), c’est normal. C’est comme ça que ça a commencé.
Ça a évolué lorsque Patrick – qui était un peu le geek de la bande -, nous a fait remarquer que nous ne pouvions plus rester sur Skyblog ; nous n’étions pas propriétaires de la plateforme, donc du contenu ; les choses pouvaient changer du jour au lendemain, nous étions susceptibles de perdre tout notre contenu ainsi que notre communauté si d’aventure la boîte fermait. Tout disparaîtrait en même temps que la plateforme. C’est là qu’il nous a proposé de monter notre propre site, pour nous rendre propriétaire du contenu. C’était en 2008. Nous quittons Skyblog et nous lançons donc fashizblack.com. C’était plutôt un gros succès, ce qui nous a permis d’envisager une évolution ; nous nous sommes engagé dans une belle aventure, il était cependant nécessaire que nous commencions à gagner de l’argent.
A ce moment-là nous nous sommes dit que si nous voulions gagner de l’argent avec le site, il nous fallait passer à un niveau supérieur : le magazine en ligne. Et là nous avons commencé à publier des numéros – nous avions la folie de publier deux numéros par mois, j’ignore où nous trouvions l’énergie pour faire tout ça ! -, en anglais et en français. Nous avons investi dans tout ce qui allait avec la publication d’un magazine, réalisé des shootings, etc. Et puis, à un moment donné, il y a eu un dégraissage dans l’équipe, qui est passé de trente à huit personnes. Ensuite de huit à six. Dès que nous sommes passé à six le magazine a décollé très rapidement : nous avons fait du crowdfunding, levé des fonds, nous sommes passé du web au papier… Aujourd’hui encore, nous développons le magazine.

L : comment gère-t-on une équipe de trente personnes ?
PAN : on ne la gère pas, on la subit. C’était ingérable mais avec le recul, c’était instructif. Mais clairement, ça a été de la folie furieuse. Je pense qu’à l’époque, nous n’avions pas encore la maturité nécessaire, nous n’étions pas prêts à devenir entrepreneurs. Enfin, je ne prévoyais pas de devenir entrepreneur, donc j’ai subi la situation. Je considérais Fashizblack comme un hobby au début, c’était une sorte de second blog. Ce n’était pas censé être quoi que ce soit d’autre. Et puis c’était un peu un projet créatif collectif, nous accueillions toutes les personnes intéressées par le projet, qui souhaitaient le rejoindre et qui pouvaient lui apporter quelque chose en leur disant : « viens, on verra ce qu’on peut faire ensemble ! » Cependant, à un moment donné, la notoriété du site était telle que nous nous sommes rendu compte que nous tenions quelque chose. Entre la tentative de piratage sur Skyblog et le soutien de la communauté, nous avons réalisé que nous tenions vraiment quelque chose et que nous devions commencer à nous structurer.
Lorsque nous commençons à nous structurer, nous nous rendons compte que trente personnes, c’est un peu beaucoup. Des personnalités se révèlent, nous commençons à montrer les crocs, à devenir plus rigoureux. Parce que nous avons conscience que notre projet vaut quelque chose – que nous voulons en faire quelque chose -, et que nous refusons de le laisser s’écrouler à cause de problèmes d’ego ou de manque de professionnalisme. Nous nous sommes dit : « c’est maintenant ou jamais », et nous avons tout donné. Après tu sais il y a un truc magnifique qui s’appelle la sélection naturelle, plus le travail s’est compliqué et plus le mammouth s’est dégraissé. Il a fondu tout seul. Jusqu’à ce qu’il ne reste que six personnes dans l’équipe. Là, le magazine est allé quinze fois plus vite et quinze fois plus haut, parce que ceux qui étaient restés étaient ceux qui étaient prêts à s’investir.
C’était une expérience enrichissante, aussi bien en matière de management d’équipe que de connaissance de l’humain. De son fonctionnement. Il y a eu des erreurs de jeunesse, de l’immaturité aussi. Enfin nous étions jeunes – le magazine a été lancé quand j’avais dix-huit ans quand même. Je n’avais absolument pas la maturité ni le recul que j’ai aujourd’hui. Quand je revois certaines choses je rigole en me demandant « mais à quoi on pensait ?! » (Rires) Ce n’était pas de tout repos, ça c’est clair !

LD : tu as parlé de professionnalisation, quand je regarde le magazine oui, il est très très professionnel. Aucun doute là-dessus.
PAN : merci.
L : vous êtes perfectionnistes. Quand j’ai appris que Fashizblack avait été créé par un trio de camerounais, j’ai eu un réflexe involontaire ; je me suis dit : « ah ouais, c’est des africains qui l’ont crée en fait ! Et ce sont des camerounais en plus ?! Ok. » C’était une réaction spontanée. On se dit que les africains francophones ne sont pas aussi professionnels, les finitions ne sont en général pas aussi léchées, abouties. C’était surprenant qu’un magazine de cette facture soit le fait de camerounais.
PAN : on la suscite tout le temps. Je pense qu’une de mes grandes chances est d’être tombée sur Patrick et Laura. En ce qui concerne Laura, nous avons un profil assez similaire : nous venons toutes les deux de Douala, nous avons toutes deux fait une école de commerce. J’ai fait une prépa, elle en a fait une également… Nous avions toutes les deux des Skyblog à l’époque, chacune de nous écrivait beaucoup. Nous étions aussi très portées par le luxe – j’ai fait mon stage chez le groupe Gucci, elle a fait le sien chez Kenzo… Nous avons énormément de points communs. C’est pareil avec Patrick. Nous réfléchissons tous les trois de la même manière. Et je peux te dire qu’en dix ans de collaboration, nous ne nous sommes jamais engueulés. En dix ans, quand même ! Et Dieu sait que nous en avons traversé des situations ! En dépit de cela, nous ne nous sommes jamais disputés, ou fâchés.
Et s’il arrive que l’on se sépare pour des questions purement administratives, nous sommes toujours… Hier soir par exemple, nous avons dîné tous les trois comme si nous nous étions quittés deux jours plus tôt. C’est une vraie chance – j’ai même envie de dire que c’est plutôt une bénédiction – de tomber sur des associés qui ont vraiment la même vision que soi, des associés qui peuvent vous remplacer sans crainte. Je sais que quand je ne suis pas là et que j’ai donné des consignes, même si mes explications ne sont pas complètes, Laura a compris. Idem pour elle, idem pour Patrick… « Ça roule ». J’ignore comment le dire autrement. Pour poursuivre dans ce sens, l’un de nos trois points communs est que nous sommes très très très exigeants. Et avec nous-même, et avec notre activité.
Cela s’est toujours passé ainsi. Nous sommes du genre à ne pas publier les magazines si nous n’en sommes pas satisfaits, même s’ils doivent sortir en retard pour ça. C’est presque une obsession. Ce n’est même plus pour les lecteurs, c’est pour nous d’abord. Si je prends mon cas en particulier, j’ai encore de cette part un peu cassante en moi, c’est une discipline que je m’impose, et je l’impose forcément un peu à ce que je fais. Pour moi Fashizblack était un peu la vitrine de mes activités, je n’avais pas envie de rigoler avec ça. Je ne voulais pas qu’en voyant le magazine dans les kiosques – parce qu’il était en kiosque à l’international à un moment -, que les gens se disent que c’est de l’à-peu-près. Ce n’était pas parfait, surtout au tout début (le magazine comportait des coquilles, des fautes de syntaxe), j’avais envie de me tuer en les repérant parce que la rédaction était de mon ressort ; c’était d’autant plus mortifiant.
Après la sortie d’un numéro, nous devions le débriefer. Nous ne nous pardonnions rien. Cette habitude est restée. Quand nous débriefons un numéro, nous n’avons pas le temps de regarder ce qui a été bien fait, nous repérons et passons du temps sur ce qui ne va pas. Se montrer critique vis-à-vis de notre travail est notre façon de travailler. Laura et moi nous remettons en question quasi-quotidiennement. C’est de cette façon que nous travaillons depuis huit/neuf ans. Je pense que la rigueur que nous nous sommes imposée vient de notre éducation ; nous avons intégré les standards que nous ont inculqués nos parents quelque part. Il faut toujours viser l’excellence. Que nous y parvenions ou pas, c’est l’objectif à viser. S’améliorer en permanence est une nécessité. Cela fait de nous des gens très critiques avec les gens, mais nous sommes cent fois plus durs avec nous-mêmes. Nous ne nous épargnons pas. Le revers de la médaille est que nous n’avons commencé à célébrer nos succès que très tardivement.
C’est assez spécial : à chaque fois que nous réalisons quelque chose, nous célébrons pendant deux minutes. La troisième nous voit commencer à stresser pour l’après. Finalement, nous n’apprenons même pas à savourer nos petites victoires. Nous avons récemment décidé de prendre le temps de le faire. Nous avons dit ça mais je nous connais : nous allons sabrer le champagne, boire une coupe, puis nous allons nous dire « allez il faut qu’on aille travailler sur le numéro d’après. On va faire quoi ? Etc. » Nous nous n’avons pas le temps de nous reposer sur nos lauriers, nous nous y remettons très rapidement et nous ne savourons pas forcément nos petites victoires. Je pense qu’à ce niveau, Fashizblack a été une très bonne école. Ce que j’y ai appris me sert dans tout ce que je fais aujourd’hui. J’essaie d’y mettre la même rigueur. Je pense que les clients que j’ai viennent surtout pour cela.
LD : votre culture organisationnelle est géniale.
PAN : merci, c’est gentil.
Retour sur son mindset

LD : Passons à ton apprentissage du métier à présent ; j’ai l’impression qu’il comporte beaucoup d’autodidactie : aller chercher l’information semble être une seconde nature chez toi, tu ne t’es pas contenté de ce qui était disponible… Je sens de l’insatisfaction dans chacune de tes productions, comme si ce n’était jamais assez pour toi. Tu vas toujours plus loin que ce qui est attendu, tu repousses la limite plus loin à chaque fois. C’est à mon sens ce qui te vaut ta notoriété. Tu ratisses large mais, paradoxalement, ton expertise est très aiguë. Comment expliques-tu cela ?
PAN : je suis une nerd. C’est vraiment en corrélation avec ce que j’expliquais il y a un instant sur le jusqu’auboutisme. Je suis perfectionniste, cela se traduit par le fait de ne pas pouvoir dormir tranquille tant que je n’ai pas complètement perçu – à défaut d’avoir compris – les différents angles d’un problème, d’un sujet, etc. Je fais partie de ces gens qui vont jusqu’à la quinzième page de Google pour trouver ce qu’ils cherchent. Je ne m’arrête pas tant que je n’ai pas tout lu. Ça peut sembler un peu maniaque mais oui, j’en ai besoin. Cela me conforte quand je dis quelque chose, parce qu’il faut que mes propos s’appuient sur des choses concrètes. Pour que ce soit le cas, il me faut effectuer une réflexion, et pour cela j’ai besoin d’absorber une quantité d’information importante. Je « mange » de l’information H24. Être aux faits de nouvelles informations fait partie de mes règles, ne jamais se coucher sans avoir appris quelque chose de nouveau – sur soi ou sur le monde – est devenu une hygiène de vie.
Cette loi que j’applique quotidiennement explique le fait que, en ce qui concerne mes sujets d’intérêt, j’ai l’impression que le monde est tellement vaste, que ce serait vraiment bête que je baigne dans mes certitudes et aie l’illusion de « maîtriser le sujet » (rires) alors que chaque jour qui passe voit quelque chose de nouveau advenir, quelque chose qui change un tout petit peu la donne dans ce que je savais hier, y ajoute de nouvelles nuances, etc. J’ai conscience qu’il s’agit d’une quête sans fin, qui ne s’arrête jamais. Je le considère comme un sport, une discipline comme une autre, qu’il faut pratiquer de façon régulière. Aller chercher l’information, faire de la veille, ne pas rester dans sa zone de confort, etc. La part de journalisme a une influence non négligeable sur moi car quand on travaille dans les médias, le minimum est d’aller à la recherche de l’information, ne pas attendre qu’elle nous trouve. Tu es celui qui fabriques l’information, tu dois constamment être en quête de sources. Faire de la veille s’apparente à la respiration ou à la marche à mon sens, cela fait partie de ma routine, c’est la façon dont je fonctionne.
Je vois mon cerveau comme un grenier, dans lequel je stocke les informations après les avoir rangés. J’ignore à quel moment elles vont me servir mais je suis convaincue qu’elles vont m’être utiles, alors je les engrange. J’y réfléchis, je les intègre. Puis il arrive toujours une situation ou un moment, une rencontre, une conversation… au cours de laquelle se produit le déclic. L’information a trouvé sa place dans une construction, je peux en user. Ce n’est pas automatique, il peut se passer trois mois sans que je n’y ai repensé quand soudain, je me rappelle de quelque chose. Le cerveau est un organe formidable, dont nous n’exploitons pas toutes les capacités, l’utiliser de façon intelligente est le minimum que je puisse faire. Evidemment, ces données englobées sont orientées, biaisées, et ne sont relatives qu’à des domaines qui me concernent directement. Mais je pars du principe que lorsqu’il s’agit d’un sujet qui me tient à cœur, j’ai intérêt à me plonger dans les détails les plus infimes, les plus profonds ou même les plus insignifiants, afin de pouvoir développer une connaissance fine de mon sujet. Parce que cela peut m’être utile. C’est ainsi que je l’envisage.
Cela peut parfois donner l’impression que je suis une espèce de « madame je sais tout »… Ce n’est pas ainsi que je procède, cela ne correspond pas à ce que je fais, à ma conception de mon rapport à l’information. J’en accumule quotidiennement, ce qui explique que lorsque – sur un sujet d’intérêt -, quelqu’un me dit A, je vais être capable de le dérouler jusqu’à Z. Parce que j’ai pris le temps d’emmagasiner de l’information, de la traiter, de l’analyser, de la mettre à l’épreuve des faits, d’en saisir les nuances, d’en rechercher les failles, les opportunités, etc. L’information est une matière première que je travaille afin d’en faire quelque chose d’utile. C’est un mode de fonctionnement.
LD : j’ai lu ta récente interview sur Btendance. L’on t’a demandé de parler de l’évolution du hip-hop, du rap ; de la place du hip-hop dans la société… J’ai rarement vu des réponses aussi précises, aussi chronologiques. Tu maîtrises parfaitement ton sujet, ses influences, ses évolutions, ses usages, ce qui l’affecte… On a l’impression que tu t’appropries tout son univers en fait. La moindre chose qui peut avoir une incidence sur lui est connue.

PAN : ah, je vois laquelle il s’agit.
LD : c’est là j’ai commencé à saisir à quel point ton expertise était aiguë, il me fallait comprendre comment tu procédais et pourquoi cela te tenait tant à cœur.
PAN : c’est très important. J’ai intérêt à savoir de quoi je parle, surtout lorsqu’il est question d’un sujet proche de mon domaine. Je pars du principe qu’on ne peut se permettre de rester dans sa zone de confort en se contentant de maîtriser ce qui gravite autour de soi, sans explorer ce qu’il y a au-delà. Nous vivons une époque tellement globalisée, multiculturelle… qu’on ne peut plus se permettre cette posture. Après, cela prend un moment d’apprendre à sortir de son territoire immédiat pour aller à la découverte de ce que l’on ne connaît pas, mais c’est une démarche gratifiante. Aujourd’hui, j’ai développé la capacité de faire des liens entre des sujets apparemment sans rapports, qui m’aident à résoudre des problèmes au quotidien, ou à mieux appréhender le monde qui m’entoure. Lorsque je regarde un documentaire sur des skateboarders en Ethiopie par exemple, cela ne va peut-être pas me servir dans l’immédiat, mais je sais que dans trois semaines/un mois, quelqu’un va me poser une question sur l’Ethiopie, ou sur la culture urbaine africaine, etc. et que je vais me remémorer l’information d’intérêt.
J’ai fait sauter les verrous en ce qui concerne ma zone de confort et mon domaine de compétence, avoir un spectre beaucoup plus large me rend plus pertinente ; savoir comment une culture, une mode ou une tendance est utilisée, réinterprétée par différents peuples ou courants est fondamental. Je lis beaucoup sur l’entertainment sud-coréen par exemple, qui m’inspire dans mon travail. Tu vas me dire : quel est le rapport entre la Corée du Sud et la Côte d’Ivoire ? Il y en a plusieurs. Je vois des ramifications à présent, que je ne voyais pas avant ; des choses, des modèles que je pourrais réutiliser dans mon environnement. Il est vrai que la Corée du Sud est plus développée que la Côte d’Ivoire, mais elles partagent des problématiques communes. Si je n’avais pas eu l’exemple du fonctionnement de la K-pop en Corée du Sud, de l’utilisation qu’en fait le gouvernement coréen comme outil de communication sur l’image de marque du pays, cela ne m’aurait pas inspiré nombre de choses que je réalise avec mon agence.
. . . .
« C’est finiiiiiii ? » Non, rassurez-vous. Paola Audrey reste avec nous un moment encore. Il était fondamental que je comprenne sa façon de fonctionner, les origines de sa rigueur, de son expertise fine, de sa pertinence… Afin de vous les rapporter. Il est rare de tomber sur un professionnel Africain francophone qui maîtrise vraiment son sujet, qui est disposé à partager ce qu’il sait et comment il le sait avec le plus grand nombre, alors on en profite ! Si vous avez aimé, partagez l’article et abonnez-vous au blog afin de ne pas rater la suite !
Ace, @ledisrupteur
*L’interview ayant été réalisée le 28 juin 2017, « dernièrement » est relatif.
Thought
Certains propos (comme « c’était surprenant que ce soit le fait de Camerounais ») ont peut être heurtés la sensibilité de certaines personnes. Ils sont assumés et écrits tels que pensés. Il reste malheureusement rare que les Africains francophones soient à l’origine de produits qualitatifs de standards internationaux. Comme pas mal de monde, je me surprends de plus en plus à découvrir de belles pépites de leurs faits.




Un article intéressant. Surtout dès le début parce qu’effectivement il ya un problème dans le niveau d’objectifs personnels et professionnels que nous nous fixons
J’aimeAimé par 2 personnes
A reblogué ceci sur L’ŒIL DE REGINAet a ajouté:
Une pépite
J’aimeAimé par 2 personnes